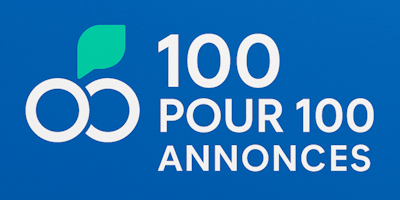En 2021, près de 281 millions de personnes vivaient hors de leur pays de naissance, selon les Nations unies, alors que la majorité des déplacements humains restent internes aux frontières nationales. Les statistiques officielles distinguent rigoureusement entre ceux qui franchissent une frontière internationale et ceux qui se déplacent à l’intérieur d’un même territoire.
Certains pays appliquent des politiques différentes selon le statut de la personne déplacée : un réfugié ne bénéficie pas nécessairement des mêmes droits qu’un migrant économique, et un immigré n’est pas automatiquement un émigré du point de vue de l’accueil. Les distinctions s’articulent autour de critères administratifs, juridiques et statistiques précis.
Migration, immigration, émigration : des définitions pour y voir plus clair
Le terme migration englobe toute forme de déplacement de personnes, que ce soit pour quelques mois ou pour la vie, à l’intérieur d’un pays ou au-delà de ses frontières. Impossible d’y réduire une réalité unique : travailleurs saisonniers, étudiants venus de loin, familles cherchant refuge après une catastrophe, ou encore personnes fuyant la guerre. Les causes varient, les statuts aussi, et chaque situation impose sa propre lecture.
Comprendre la différence entre immigration et migration, c’est d’abord changer de perspective. L’immigration s’intéresse à l’arrivée : s’installer durablement dans un autre pays fait de vous un immigré pour l’État d’accueil. À l’inverse, l’émigration regarde le départ : du point de vue du pays quitté, la même personne est un émigré.
Pour clarifier ces notions, voici les principales définitions à connaître :
- Migrant : toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel, que ce soit pour traverser une frontière ou simplement changer de région, et pour des raisons très diverses.
- Immigré : individu vivant dans un pays où il n’est pas né, peu importe la nationalité qu’il a obtenue depuis.
- Émigré : personne ayant quitté son pays d’origine pour s’installer à l’étranger.
Mais le statut du migrant ne se limite pas à ces définitions. Un réfugié se voit accorder une protection internationale selon la convention de Genève, en raison de persécutions, de conflits ou de menaces liées à ses opinions ou à son appartenance à un groupe social. D’autres types de migration, économique, familiale, relèvent de procédures nationales. Il arrive aussi que certaines personnes se retrouvent en situation irrégulière, faute de titre de séjour ou en ayant dépassé la durée autorisée.
Les questions de nationalité et d’apatridie complexifient encore le paysage : ne pas avoir de nationalité rend l’accès aux droits et à la protection plus difficile. Ces distinctions entre immigré et migrant façonnent les politiques publiques, alimentent les débats, en France comme partout ailleurs.
Quels sont les grands chiffres et tendances des migrations aujourd’hui ?
Les estimations récentes de l’Organisation internationale pour les migrations font état de près de 281 millions de personnes vivant hors de leur pays de naissance. Cela équivaut à environ 3,6 % de la population mondiale. Mais derrière ce chiffre global, la réalité est nuancée : la majorité des migrations se déroule à l’échelle régionale, loin des clichés sur des flux massifs vers l’Europe ou l’Amérique du Nord.
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime à environ 36 millions le nombre de personnes ayant dû franchir une frontière internationale pour échapper à la violence ou aux persécutions. À cela s’ajoutent plus de 62 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, contraintes de quitter leur foyer mais pas leur nation d’origine.
Ces deux listes dressent le paysage mondial des migrations forcées :
- Principaux pays d’origine : Syrie, Afghanistan, Venezuela, Soudan du Sud.
- Principaux pays d’accueil : Turquie, Colombie, Allemagne, Pakistan, France.
En France, la population immigrée atteint près de 7 millions de personnes, soit environ 10 % de l’ensemble des habitants. Les arrivées en provenance d’Afrique subsaharienne et du Maghreb augmentent, tandis que celles issues d’Europe connaissent un léger recul. Les dernières années montrent une augmentation des demandes d’asile, sous l’effet de crises internationales, et une mosaïque de profils : migrations économiques, regroupements familiaux, parcours humanitaires.
Immigré, émigré : comment distinguer ces notions sans se tromper ?
Parler d’immigré ou d’émigré, c’est choisir un angle de vue sur un même itinéraire. L’émigré est celui qui prend la route et quitte son pays d’origine. L’immigré, c’est la même personne, mais vue depuis le pays d’arrivée : il s’agit alors de celui ou celle qui s’installe durablement ailleurs. Un exemple parlant : pour la France, un Marocain établi à Paris est un immigré ; pour le Maroc, cette personne est un émigré.
Cette nuance influe sur la manière dont chacun est perçu et sur les droits auxquels il peut prétendre. En France, la statistique qualifie d’immigré toute personne née étrangère à l’étranger et installée durablement dans le pays, sans préjuger de sa nationalité actuelle. Même devenu français, le parcours migratoire demeure inscrit dans les chiffres, dans l’histoire personnelle et collective.
Voici quelques repères pour mieux saisir la distinction :
- L’émigré quitte son pays pour des motifs variés : emploi, études, regroupement familial, fuite de persécutions.
- L’immigré est désigné depuis la perspective du pays d’accueil.
Le vocabulaire employé dans l’espace public, à la télévision, dans les discussions politiques, brouille parfois ces différences. Un étranger désigne simplement une personne qui n’a pas la nationalité du pays où elle réside ; un immigré, lui, porte une trajectoire : celle d’avoir franchi une frontière et de s’être installé ailleurs. Garder ce distinguo à l’esprit permet d’éviter les amalgames, surtout lorsque la migration revient au centre du débat public.