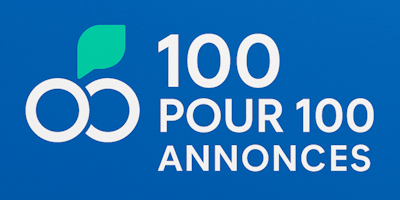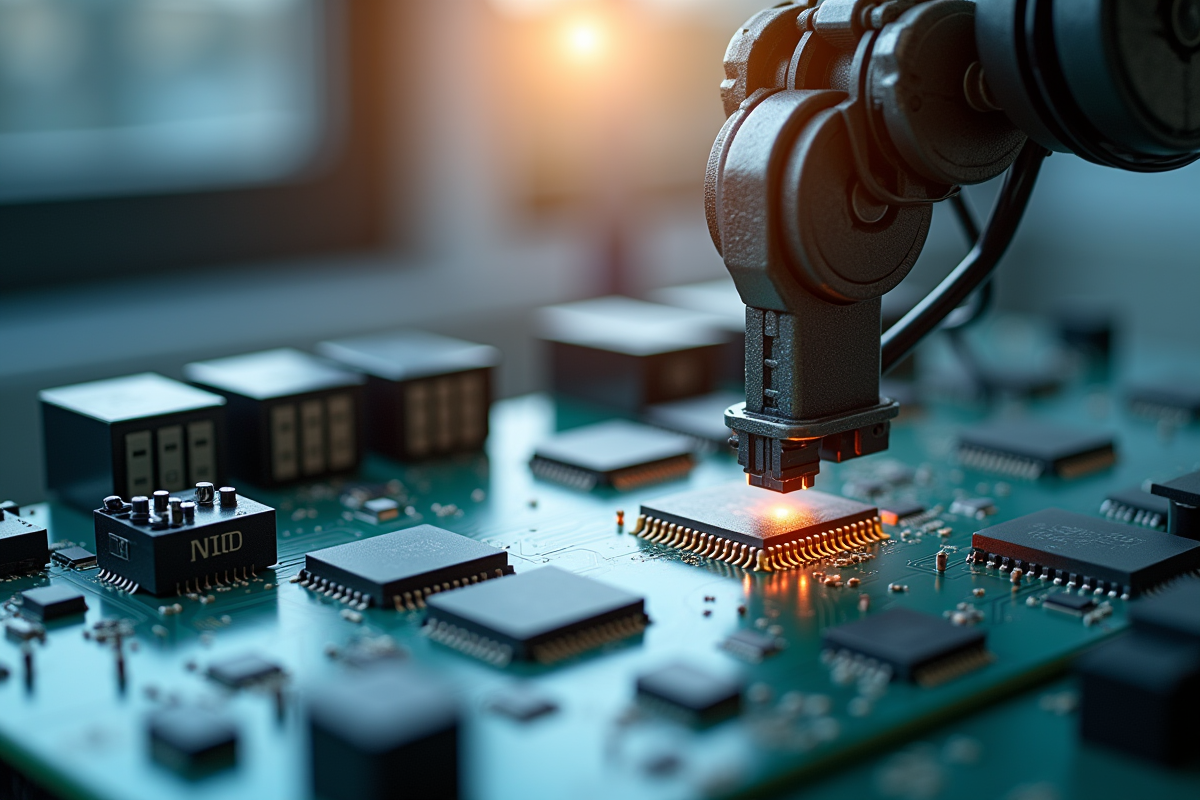Certains pays investissent plus de 3 % de leur PIB dans la recherche et le développement, quand d’autres peinent à dépasser le seuil de 0,5 %. La moitié des brevets mondiaux déposés chaque année provient de seulement trois États. Les classements internationaux de compétitivité technologique révèlent des écarts persistants, malgré la multiplication des initiatives de coopération scientifique. Ces disparités orientent durablement les trajectoires économiques et sociales à l’échelle mondiale.
Comprendre l’interdépendance entre science, technologie et développement
À l’heure où les sociétés cherchent des leviers pour avancer, la science et la technologie s’imposent comme des moteurs incontournables du développement. L’interdépendance entre ces domaines n’est plus à démontrer. L’ONU a posé un cadre structurant à travers les Objectifs de développement durable (ODD), en cohérence avec l’Accord de Paris et le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité. Derrière ces grands accords, une ambition claire : faire des avancées scientifiques de véritables réponses aux défis écologiques et sociaux d’aujourd’hui.
Mais l’apport des sciences et technologies ne se limite pas à l’innovation pure. Elles renforcent la résilience collective, améliorent la qualité de vie et s’attaquent à des problématiques concrètes, du changement climatique à la préservation de la biodiversité, en passant par l’accès à l’eau potable. Prenons des exemples parlants : en Tanzanie, les technologies médicales ont révolutionné la santé maternelle et néonatale ; à Piura, au Pérou, l’introduction des TIC dans les écoles a permis de réduire les inégalités éducatives.
Voici quelques illustrations tangibles de cette synergie entre savoirs et action :
- Le Bangladesh a engagé son industrie textile dans des pratiques d’économie circulaire. Résultat : progrès conjugués sur les ODD 9, 12 et 6, entre innovation industrielle, consommation maîtrisée et gestion raisonnée de l’eau.
- Quand la recherche s’aligne avec les politiques publiques et l’entreprise, cela donne naissance à des systèmes nationaux de science, technologie et innovation capables de mobiliser l’ensemble des forces vives face aux défis contemporains.
Ce tissu ne se limite pas à relier des disciplines. Il se construit dans la coopération, l’anticipation, l’évaluation. La recherche irrigue la décision publique, bouscule les routines et invite à repenser nos modèles de croissance. La science, loin de rester confinée dans les laboratoires, pousse à l’action, interpelle les responsabilités et se mêle au réel.
Quels sont les trois rôles essentiels dans la dynamique du progrès ?
Derrière les débats sur la science et la technologie, trois rôles structurants se détachent, portés par des alliances et des mobilisations collectives.
Le premier, c’est la production de connaissances. Prenons le Conseil scientifique international, en partenariat avec la Fédération mondiale des organisations d’ingénierie : ensemble, ils élaborent analyses et recommandations, transmises chaque année au Forum politique de haut niveau (HLPF). Ce travail irrigue non seulement les débats politiques, mais aussi l’ensemble du tissu social, accélérant la marche vers les Objectifs de développement durable.
Ensuite, il y a la coopération avec les acteurs locaux. La communauté scientifique ne travaille pas en vase clos : elle dialogue avec communautés locales, décideurs politiques, peuples autochtones et de nombreux partenaires. Cette ouverture permet d’intégrer des savoirs issus du terrain, de concevoir des solutions sur-mesure, et d’ancrer les innovations dans la réalité quotidienne.
En troisième lieu, l’inclusion et l’équité s’imposent comme un axe de transformation. Les efforts menés pour renforcer le mentorat et l’éducation STEM ouvrent des portes. Le Centre pour les femmes en STEM (CWS) au Pakistan, par exemple, donne aux femmes les moyens de s’affirmer dans les carrières scientifiques, impactant l’éducation, l’égalité et la croissance. Au Canada, un programme de mentorat et de leadership accompagne les jeunes noirs, démontrant que la justice sociale nourrit l’innovation et le développement.
C’est ce trio, savoirs, coopération, inclusion, qui façonne la dynamique du progrès. La science et la technologie, ancrées dans le concret, s’affirment comme des leviers de transformation et de justice.
Compétition internationale : enjeux et perspectives pour les sociétés de demain
La compétition internationale se redéfinit loin des logiques de puissance brute ou de simple course à l’innovation. Désormais, elle s’exprime dans la capacité à renforcer la résilience, à intégrer des savoirs variés dans chaque contexte, et à diffuser des innovations au service d’une société plus durable.
Regardons du côté de Naryn, au Kirghizistan : là-bas, un projet de résilience urbaine conjugue expertise scientifique et connaissances locales. L’objectif ? Garantir la sécurité alimentaire, affronter le changement climatique et préserver les équilibres sociaux. Cette approche, loin d’être marginale, démontre que la compétition mondiale se joue aussi dans la capacité à inventer des modèles transférables, inspirant d’autres territoires.
L’innovation, souvent présentée comme une course effrénée, prend aujourd’hui une forme plus hybride. En Colombie et au Sri Lanka, les analyses convergent : plateformes web et applications mobiles s’avèrent précieuses pour limiter le gaspillage alimentaire. Derrière ces outils, une réalité : la technologie n’avance plus seule, elle s’inscrit dans un dialogue constant avec les besoins locaux, les politiques publiques et l’engagement citoyen.
La mesure du bien-être devient un autre terrain de compétition. L’Institut international d’analyse des systèmes appliqués a mis au point le modèle GAINS, qui alimente la progression de plusieurs Objectifs de développement durable. L’indicateur « Années de bonne vie » (YoGL) propose une nouvelle lecture du progrès, intégrant santé, accès à l’énergie et qualité environnementale. Compétition ne rime plus seulement avec croissance, mais avec la capacité d’imaginer et d’appliquer des indicateurs partagés, en phase avec les défis et aspirations de chaque société.
Demain se joue déjà, sur tous les terrains où science et technologie s’allient à l’intelligence collective. L’écart ne se fait plus seulement à coups de brevets, mais à la force de l’innovation utile, inclusive, et capable de transformer durablement le quotidien.