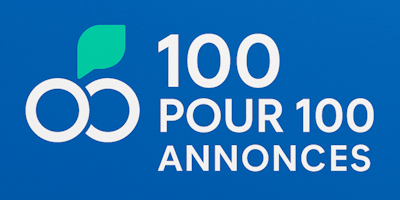Dans de nombreux environnements sociaux et institutionnels, certaines identités sont considérées comme la norme, tandis que d’autres demeurent marginalisées ou incomprises. Les termes utilisés pour désigner ces différentes positions ne sont pas toujours explicites et leur emploi peut entraîner des malentendus, voire des tensions.La distinction entre orientation sexuelle et identité de genre, souvent confondue ou ignorée, s’accompagne d’enjeux linguistiques, culturels et politiques. Comprendre les termes précis employés dans les débats actuels permet de mieux cerner les réalités vécues par chacun.
Comprendre les notions de sexe, de genre et d’orientation sexuelle : des repères essentiels
Difficile de saisir ce que recouvre le mot cishet sans revenir aux bases : sexe attribué à la naissance, genre, orientation sexuelle. Ces trois notions dessinent des contours distincts, à la croisée du regard social, de l’expérience intime et des attentes collectives.
Pour clarifier ces différences, voici les repères principaux qui structurent la compréhension de ces concepts :
- Sexe attribué à la naissance : c’est la mention portée sur l’état civil, décidée dès la naissance sur la base des organes génitaux. Ce système, qui repose sur une logique binaire (homme ou femme), ne reflète pas l’ensemble des parcours : la réalité des personnes intersexes le montre bien.
- Genre : il englobe les rôles, les codes et les normes que la société associe à chacun. L’identité de genre exprime ce que l’on ressent profondément (homme, femme, non-binaire, agenre…). Il arrive que ce ressenti ne coïncide pas avec le sexe mentionné sur les papiers d’identité.
- Orientation sexuelle : elle concerne l’attirance (affective ou sexuelle) que l’on éprouve pour d’autres personnes (hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, pansexuel, asexuel, etc.).
Une personne est dite cisgenre si elle se reconnaît dans le genre qui lui a été attribué à la naissance, un homme qui se sent homme, une femme qui se sent femme. Si cette personne est attirée par le genre opposé, on parle alors d’hétérosexuel. L’association des deux, c’est ce que l’on appelle cishet.
Mais la réalité contemporaine déborde largement ce cadre. Aujourd’hui, la diversité s’impose : non-binaire, transgenre, intersexe, queer, LGBTQ+… Ces mots manifestent le besoin de repenser les catégories traditionnelles, femme/homme, hétéro/homo, qui ne suffisent plus à décrire la complexité des trajectoires individuelles. Le langage s’adapte, se transforme, pour refléter la pluralité des vécus.
Que signifie « cishet » et en quoi ce terme éclaire-t-il les identités contemporaines ?
Le mot cishet fusionne cisgenre et hétérosexuel. Il s’applique à une personne dont l’identité de genre coïncide avec le sexe attribué à la naissance, et qui est attirée par le genre opposé. Au premier abord, la définition paraît simple, presque anodine. Pourtant, elle révèle un phénomène social puissant : ce qui était tenu pour neutre ou « normal » n’avait même pas de nom jusqu’à récemment.
Le terme cishet est apparu dans les débats et les mobilisations LGBTQ+. Il désigne la position qui servait jusqu’alors de référence silencieuse, celle autour de laquelle s’articulent toutes les autres identités : trans, non-binaires, queer, intersexes. Nommer ce centre, c’est le rendre visible et interroger la notion de normativité, ainsi que ses conséquences pour chacun dans la société.
Le lexique va plus loin : cishetallo (qui signale l’alloromantisme et l’allosexualité), pericishet (pour désigner ceux qui ne sont pas intersexes), ou encore monoallocishet. Chaque terme affine la cartographie des identités de genre et de sexualité. Mettre des mots sur ce qui semblait aller de soi, c’est aussi mettre à nu les mécanismes d’accès au pouvoir ou aux privilèges. Les mots déplacent notre perspective collective.
Regards sur les enjeux sociétaux : privilèges, représentations et inclusion autour du terme « cishet »
Employer le mot cishet, c’est braquer le projecteur sur ce qui, souvent, reste implicite. Ce terme rend visibles les privilèges associés au fait d’être à la fois cisgenre et hétérosexuel. Bien souvent, cette combinaison définit la norme : accès facilité à de nombreux espaces, surreprésentation dans les médias, moindre exposition à la discrimination ou à la violence. Ces avantages sont tellement ancrés dans le quotidien qu’ils finissent par se fondre dans le décor.
La normativité cishet ne s’arrête pas aux interactions privées : elle influence aussi les politiques publiques, la visibilité accordée aux personnes trans, non-binaires ou queer. Remettre en question ce cadre, c’est interroger l’évidence et les routines. Mettre les choses à plat, c’est ouvrir le débat sur l’accès aux droits, la reconnaissance, la place de chacun.
Pour illustrer concrètement ces privilèges, voici quelques situations courantes :
- Accès facilité aux droits légaux
- Surreprésentation dans les médias
- Moindre risque de stigmatisation ou de violence
Même au sein de la communauté LGBTQ+, l’usage du terme cishet ne fait pas l’unanimité. Certains mouvements, dits exclusionnistes, l’utilisent pour marquer des frontières, notamment à l’encontre des personnes a-spec. Ces débats rappellent que l’inclusion nécessite une attention continue : s’informer, écouter, remettre en perspective ses propres privilèges. Les mots, loin d’être neutres, délimitent les possibles, ouvrent ou ferment des portes, et pèsent sur les dynamiques collectives.
Nommer ce qui paraissait aller de soi, c’est inviter à changer de regard. Reste à voir jusqu’où cette prise de conscience collective nous mènera.